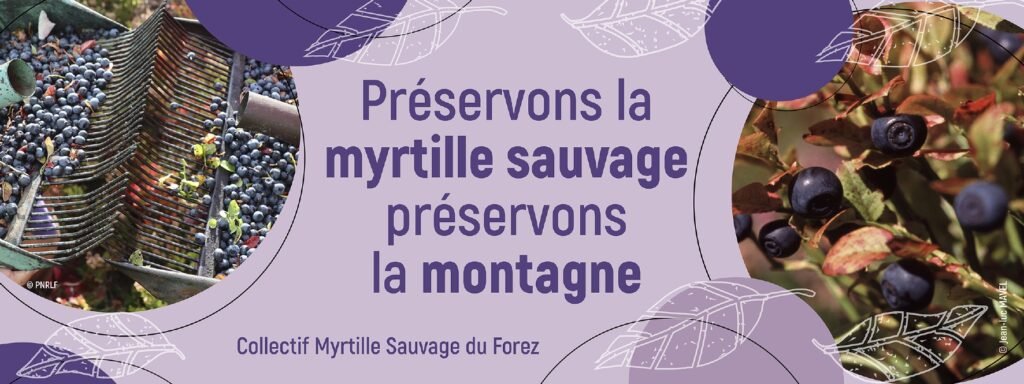Les landes à myrtilles sont pour partie classées habitats d’intérêt communautaire au niveau européen. Elles constituent une ressource naturelle emblématique et intéressante à plus d’un titre.
La myrtille sauvage est un fruit de cueillette aux nombreuses propriétés. Elle est composée d’anthocyanosides (pigments responsables de la couleur violette de la chair) qui améliorent l’acuité visuelle. C’est aussi une mine de vitamines : A, B1, B2, B6, C et E. Elle apporte fer, magnésium, potassium et phosphore en quantité. Très riche en fibres elle a également des propriété astringentes, antiseptiques, antioxydante et laxatives qui ont une action bénéfique sur le transit intestinal. Enfin, elle a également un rôle bénéfique pour la santé cardiovasculaire et contre le vieillissement cellulaire. La feuille, utilisée en décoction, a également des vertus antidiabétique et drainante. En usage externe, elle est utilisée pour l’eczéma. Autrefois, on utilisait notamment les baies pour colorer le vin. On en donnait également aux vaches lorsqu’elles avaient des problèmes intestinaux. Aujourd’hui, on réalise surtout des confitures et des tartes, mais aussi des jus, des sirops, de la glace, de la bière, de la pâte de fruit, etc.
Elle se situe au carrefour de nombreux enjeux : maintien de pratiques de pâturage extensives, amélioration et diversification du revenu agricole, développement de la sylviculture sous couvert continu (c’est-à-dire sans coupe rase), préservation de la biodiversité et des milieux naturels, transmission des savoir-faire de cueillette et du patrimoine culinaire associé, adaptation aux effets du changement climatique, … La préserver, c’est préserver la montagne, ses paysages et ses traditions.
Sur l’ensemble des territoires du Massif central, la myrtille sauvage a commencé à être commercialisée dans les années 1 900-1910 et a connu sa période faste dans les années 1950 à 1980. L’activité de cueillette est devenue ensuite moins prospère à une époque où l’alimentation s’est tournée davantage vers des aliments transformés voire ultra-transformés. Mais depuis les années 2010, les professionnels de santé mettent l’accent sur les bienfaits d’une alimentation équilibrée, basée sur des aliments bruts ou peu transformés ; la myrtille sauvage est alors identifiée comme un « superaliment ».
Pourtant, alors que la demande est forte et les prix de vente attractifs pour les acteurs économiques, l’offre actuelle ne permet pas de répondre à la demande. Plusieurs raisons sont identifiées. Fruit sauvage à la cueillette aléatoire, la myrtille sauvage n’offre pas de revenus réguliers. De fait, les acteurs économiques ont du mal à se structurer et se fédérer autour d’un outil de valorisation ou de reconnaissance.
Le changement climatique est pour partie responsable de l’augmentation des aléas de cueillette. Gels tardifs, sécheresse, faible couverture neigeuse et orages de grêles peuvent impacter fortement le rendement des myrtillers lorsqu’ils interviennent à des moments clés du développement de la baie (floraison notamment). Il facilite également l’apparition ces dernières années, comme sur d’autres espèces fruitières, d’un ravageur : une petite mouche nommée Drosophila suzukii. Cette dernière peut causer des pertes importantes sur les fruits et contraindre à une cueillette précoce.
Par ailleurs, l’évolution des pratiques de pâturage, qu’elles soient peu présentes (déprise pastorale) ou trop intensives (surpâturage), s’accompagnent de transformations massives de la composition des landes à myrtille (colonisation de fougères, d’arbustes ou à l’inverse appauvrissement de la flore). De même, le changement brutal de couvert imposé lors de coupes rases et replantations forestières perturbe le cycle de développement du myrtillier. Le couvert boisé, s’il ne laisse pas passer suffisamment la lumière, ne permet pas la fructification des myrtilliers.
Enfin, localement, la concurrence d’autres pays européens (du Nord et de l’Est) sur les marchés économiques contraint également la structuration de filières locales. Sur certains territoires, on constate même l’abandon progressif des pratiques de cueillette du fait du vieillissement de la population agricole et la pénibilité de la cueillette, notamment dans les zones difficiles d’accès, ou du fait des difficultés d’obtenir la maîtrise du foncier de cueillette.
Pour autant, malgré ces difficultés, le potentiel que représente les landes à myrtille du Livradois-Forez mérite que l’on se donne les moyens de préserver et de valoriser cette ressource.